Dans la nouvelle économie, les entreprises, si elles peuvent entrevoir des possibilités de croissance et de profit inespérées, sont également confrontées à une difficulté inédite. Comment protéger les avoirs immatériels qui font la valeur de leur production ?
L’immatérialité est à la fois leur chance et leur talon d’Achille comme le montre leur obsession de la copie et de la contrefaçon. La copie a toujours été possible et les entreprises n’ont eu de cesse de sa protéger contre elle. Au tournant du millénaire, la nouveauté est que la copie est devenue à la fois plus facile et plus rentable. En faisant l’économie de la conception, le contrefacteur accède immédiatement au rendement maximal que le producteur « original » n’atteint qu’après avoir amorti d’importants coûts fixes. Pour un bien industriel « classique », la copie peut être intéressante mais elle suppose tout de même de supporter des coûts de production généralement d’autant plus élevés que la copie est fidèle. Si, au contraire, la valeur d’un bien réside dans un contenu numérique démultipliable à l’infini sans aucun frais ou presque, si elle consiste dans une marque qu’il suffit d’apposer dessus, alors la copie ne coûte pratiquement plus rien. Il suffit de cliquer sur son ordinateur ou de reproduire un logo. Le producteur de faux sacs Vuitton n’a aucun frais de publicité tout en bénéficiant à plein de la notoriété de la marque. De même, le producteur de faux médicaments ne supporte aucune dépense de recherche et développement. Idem pour celui qui pirate un logiciel ou copie un contenu numérique – chanson ou film. Ce n’est pas le moindre paradoxe de la nouvelle économie qui, tout en générant des profits extraordinaires, est fondamentalement une économie de la gratuité. Ce qui ne veut évidemment pas dire que ses entreprises soient prêtes à se convertir à la gratuité, comme le montrent les très nombreux procès en contrefaçon qu’elles ont intentés et leur lobbying effréné pour obtenir la pénalisation des contrefaçons et copies illégales.
Pour maintenir leurs marges et résister à la captation de leur rente par des contrefacteurs, les entreprises doivent s’assurer l’exclusivité de ce qui fait la valeur de leur biens et qui ne peut être physiquement approprié. Elles ont recours pour ce faire à ce que l’on nomme la « propriété intellectuelle ». Le terme est trompeur. La propriété d’un bien immobilier n’est que la traduction juridique de sa possession physique. La propriété intellectuelle est une faculté en soi. Elle ne sanctionne pas l’impossibilité de jouir d’un bien lorsqu’un autre le possède. Elle dit seulement que le titulaire du droit de propriété maîtrise les conditions dans lesquels ce bien immatériel peut être utilisé par d’autres : interdiction (juridique avant d’être éventuellement physique) ou sous licence en contrepartie du versement d’un revenu. C’est le cas des logiciels vendus sous licence.
Le droit de la concurrence qui vise à assurer une pluralité d’offre et à protéger les consommateurs contre les agissements d’éventuels monopoleurs entre en conflit avec celui de la propriété intellectuelle qui est le socle même du business model de nombreuses entreprises dans des secteurs aussi divers que l’informatique, la pharmacie ou le luxe. Ainsi le cas Microsoft est exemplaire. Que demande la Commission européenne à Microsoft dans la partie de sa décision consacrée à l’interopérabilité ? Elle lui demande en définitive de renoncer à la propriété exclusive de certaines lignes de code grâce auxquelles elle assurait un avantage compétitif à ses produits sur ceux de ses concurrents. S’il ne s’agit pas de céder formellement la propriété intellectuelle de ces lignes, cela revient à renoncer aux avantages que celle-ci procure en la mettant à disposition soit gratuitement soit contre une rémunération raisonnable, cette rémunération étant d’ailleurs un des points en discussion entre la Commission et Microsoft.
Dans cette affaire, la tension entre les principes de concurrence et de propriété s’est manifestée au sein même de la Commission européenne dans les rapports de force entre directions générales. Pendant l’instruction, les fonctionnaires en charge des dossiers « société de l’information » ont plaidé pour une position très dure à l’égard de l’entreprise, parce qu’ils mesuraient ce que son comportement impliquait comme blocages dans l’industrie du fait de la « rétention » de données techniques. Pour eux, Microsoft agissait en monopoleur et empêchait tout simplement le développement de l’offre. A l’inverse, Microsoft plaidait que la protection de ses droits sur les lignes de codes était une condition de l’innovation et du développement du marché parce qu’elle garantit un retour sur l’investissement préalable à la commercialisation de nouveaux produits.
Telle était également la position des fonctionnaires de la direction générale du marché intérieur qui voulaient faire primer les principes de la propriété intellectuelle (dont la réglementation relève de leur compétence). La petite équipe en charge du dossier à la direction générale de la concurrence a finalement dégagé une synthèse entre ces deux approches.
La différence entre les décisions européenne, d’une part, et américaine, de l’autre, n’a rien d’anecdotique. Le droit de la concurrence de l’Union amène la Commission, bien qu’elle s’en défende, à porter le fer au cœur du modèle économique de la nouvelle économie. C’est précisément l’audace d’agir de la sorte qui distingue la position de Bruxelles. S’agit-il d’une constante ou bien d’un cas isolé ?
Fin des bonnes feuilles sur la concurrence. On se retrouve la semaine prochaine avec les vols secrets de la CIA.

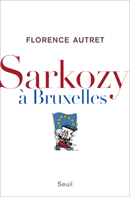
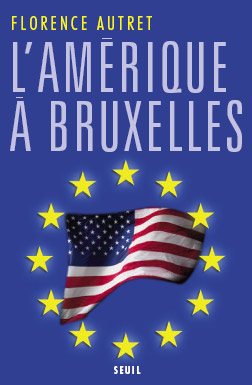






Madame,
Si je suis entièrement d'accord sur ce que peut être la valeur ds une économie numérique (un contenu mais démultipliable à l'infini, une marque mais apposable sans frais etc.), je reste davantage perplexe sur l'exemple du médicament. Il me semble que le problème est moins pour le fabricant (à moins que l'ICH n'ait publié des études sur ce sujet) celui du faux médicament que celui des importations parallèles ou encore celui de l'extension de la durée du brevet lorsqu'une amélioration est apportée au médicament, amélioration dont la preuve n'est pas toujours rapportée. Je pense ici à un certain nombre de jp du juge communautaire. Je crois que ce sont là les grandes batailles de l'industrie pharmaceutique, yc ds le cadre de l'OMS. Autrement dit et c'est quasiment une demande, à défaut d'être une commande, travaillerez vous sur un tel sujet ?
Rédigé par : JYR | 09 mars 2007 à 16:19
Monsieur,
merci pour votre commentaire sur le médicament. Vous êtes certainement plus expert que moi sur ce sujet. Une chose est sûre : la question est incontestablement compliquée par la nature de la demande sur ce marché où les consommateurs (les malades) ne sont pas les prescripteurs (les médecins) qui eux même diffèrent des payeurs (les organismes d'assurance sociale). On est donc dans un système dont la régulation est pour le moins ardue. Et là encore, vous m'excuserez de rester à la surface des choses, se pose un pb transatlantique.
Vous verrez dans la conclusion de "L'Amérique" que je mentionne le pb de la fixation du prix du médicament dans les systèmes de santé européen. C'est un élément de régulation qui gêne évidemment certains labos (même s'ils savent que c'set la contrepartie d'une certaine solvabilité de la demande) et certaines personnes connaissant fort bien les arcanes de la politique commerciale prétendent que ces labos attaqueront un jour ou l'autre l'Europe devant l'OMC, par gouvernement américain interposé, pour faire sauter le contrôle exercé par les autorités nationales sur le prix du médicament (lequel se justifie par la structure atypique de la demande mentionnée plus haut et par les contraintes budgétaires des systèmes d'assurance santé).
Le médicament sera peut-être la prochaine guerre commerciale transatlantique.
Mais j'ai bien conscience de ne pas répondre à votre question.
Au plaisir de vous lire encore.
FA
PS : le livre est sorti la semaine dernière.
Rédigé par : Florence Autret | 13 mars 2007 à 10:59